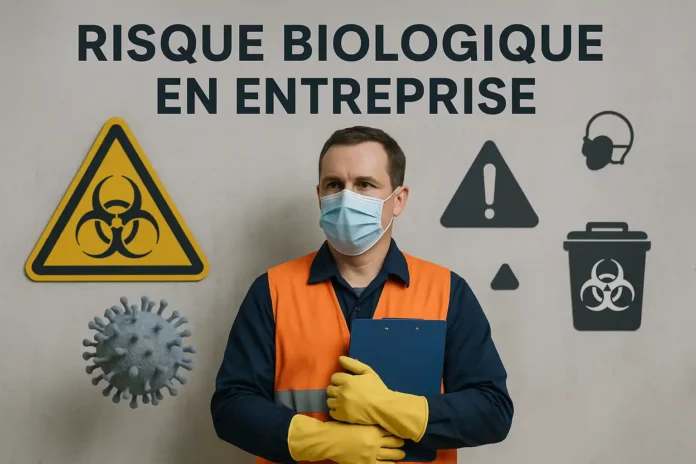Un technicien d’entretien qui manipule des sacs-poubelles, une aide-soignante qui change un pansement, un agent de maintenance qui intervient sur une tour de refroidissement… Ces situations de travail n’ont a priori rien en commun. Et pourtant, elles exposent toutes à un danger invisible mais bien réel : le risque biologique. Trop souvent associé uniquement au milieu hospitalier, ce risque concerne en réalité une multitude de secteurs. Avec la pandémie de Covid-19, les entreprises ont pris conscience de l’impact majeur que peuvent avoir les agents biologiques sur la santé, l’organisation et l’économie.
En 2025, la réglementation est claire : l’évaluation du risque biologique fait partie intégrante du Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP), et les employeurs ont l’obligation de protéger leurs salariés. Mais concrètement, que recouvre ce risque ? Qui est concerné ? Quelles sont les obligations et les bonnes pratiques à mettre en place ?
🔥 Ça discute en ce moment...
1. Qu’est-ce que le risque biologique ?
Le Code du travail définit les agents biologiques comme des micro-organismes (bactéries, virus, parasites, champignons, cellules en culture) susceptibles de provoquer des infections, des allergies ou des intoxications (article R.4421-1). Ces agents sont classés en quatre groupes de danger selon leur niveau de risque, allant de l’agent peu susceptible de provoquer une maladie (groupe 1) à celui entraînant une maladie grave sans traitement efficace (groupe 4, comme Ebola).
👉 Concrètement, le risque biologique désigne la possibilité d’être exposé, lors de son travail, à ces agents dangereux. Cette exposition peut être :
- Directe : piqûre, coupure, projection de sang ou de fluides, inhalation.
- Indirecte : contact avec des surfaces contaminées, poussières, climatiseurs mal entretenus.
À lire aussi sur mondedutravail.fr : Les risques psychosociaux au travail : ce que tout salarié devrait savoir
2. Les secteurs d’activité les plus exposés
Si les soignants et chercheurs sont évidemment concernés, d’autres métiers présentent un risque souvent sous-estimé.
- Santé et médico-social : hôpitaux, cliniques, EHPAD, laboratoires.
- Propreté et gestion des déchets : agents de nettoyage, centres de tri, assainissement.
- Agroalimentaire : manipulation de denrées, stockage, abattage.
- Construction et maintenance : exposition à la légionelle dans les réseaux d’eau, moisissures dans les bâtiments.
- Espaces verts et agriculture : risques liés aux spores, au tétanos, aux zoonoses.
- Bureaux : épidémies saisonnières, propagation de virus par climatisation ou contacts rapprochés.
Exemple concret : un salarié qui manipule des cartons moisis dans un entrepôt peut développer une mycose pulmonaire. Ce type de cas illustre combien le risque biologique dépasse largement le seul cadre médical.
3. Les obligations légales de l’employeur
L’employeur a une obligation de résultat en matière de santé et sécurité au travail (article L.4121-1 du Code du travail). Cela implique notamment :
- Évaluer les risques et les inscrire dans le DUERP.
- Classer les agents biologiques selon les 4 groupes de danger.
- Mettre en place des mesures de prévention adaptées : organisationnelles, techniques, humaines.
- Informer et former les salariés exposés.
- Proposer, lorsque c’est pertinent, la vaccination (hépatite B, grippe, tétanos…).
- Mettre en œuvre une traçabilité (registre des expositions, suivi médical renforcé).
📌 Références utiles :
4. Conséquences pour les salariés et les entreprises
Le risque biologique a des effets multiples :
- Sanitaires : maladies infectieuses (hépatite, tuberculose, légionellose, Covid-19, zoonoses), dermatoses, allergies.
- Économiques : arrêts maladie, désorganisation des équipes, perte de productivité.
- Sociales et juridiques : reconnaissance en maladie professionnelle (tableaux n°45, 46, 56 du régime général), responsabilité pénale de l’employeur en cas de négligence.
👉 Exemple : la tuberculose contractée par un soignant peut être reconnue comme maladie professionnelle et entraîner une réparation intégrale.
5. Mesures de prévention concrètes
La prévention repose sur une combinaison de mesures :
- Organisationnelles : procédures de nettoyage et désinfection, plan de prévention avec les sous-traitants, gestion des déchets contaminés.
- Techniques : hottes aspirantes, ventilation, systèmes fermés, entretien des climatiseurs.
- Humaines : port d’équipements de protection individuelle (gants, masques, lunettes), vaccination, sensibilisation.
Exemple terrain : un service de nettoyage met en place des sacs à déchets résistants, une formation sur le port des gants et un protocole de lavage des mains après chaque collecte. Résultat : baisse des accidents d’exposition au sang.
6. Le rôle du CSE / CSSCT et de la médecine du travail
- CSE / CSSCT : participe à l’évaluation, discute des mesures à adopter, fait remonter les alertes terrain.
- Médecin du travail : organise le suivi médical renforcé, propose des aménagements, veille aux campagnes de vaccination.
Cette collaboration est essentielle : elle permet une vision globale et partagée du risque, gage d’efficacité dans la prévention.
👉 À lire aussi : CSE et CSSCT : missions et rôle en 2025
7. Risques émergents et perspectives
- Covid-19 a démontré la vulnérabilité des entreprises face aux épidémies.
- Grippe aviaire et zoonoses : risques croissants dans l’agroalimentaire et l’élevage.
- Résistance aux antibiotiques : enjeu de santé mondiale qui impactera aussi les milieux professionnels.
- Digitalisation de la prévention : des outils comme document-unique.online permettent aujourd’hui aux entreprises de cartographier leurs risques biologiques, d’assurer la traçabilité et de simplifier la mise à jour du DUERP.
Conclusion
Le risque biologique est invisible, mais ses conséquences sont bien réelles. Chaque entreprise, quel que soit son secteur, doit intégrer ce risque dans sa politique de prévention. Former, informer, équiper et protéger les salariés n’est pas seulement une obligation légale : c’est une nécessité humaine et organisationnelle.
En 2025, il n’est plus possible d’ignorer ce danger. Les entreprises qui investissent dans la prévention gagnent sur tous les plans : santé des salariés, sérénité des équipes, image responsable et continuité d’activité.